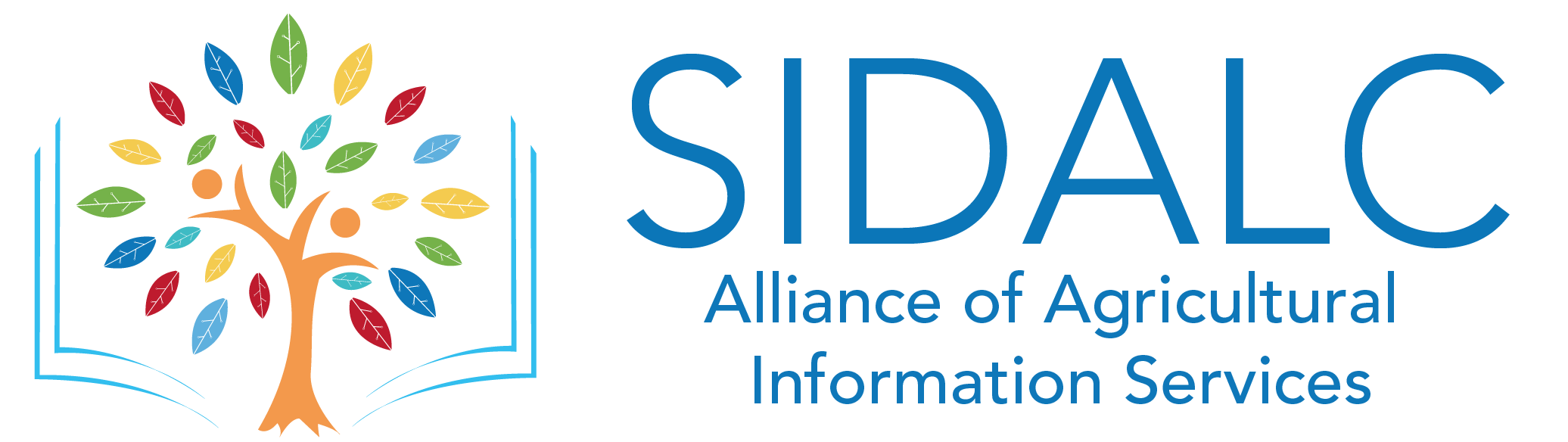Lutte intégrée contre les ravageurs
Les avantages de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures pour les agriculteurs des pays en développement ne sont plus à démontrer. Ce système permet de diminuer les coûts de production en limitant la dépendance vis-à-vis des produits phytosanitaires, de réduire les risques pour l'homme et pour l'environnement et, dans le même temps, de stabiliser les rendements en assurant la survie des ennemis naturels des principaux parasites. Les grands principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures sont simples. Toutefois, leur mise en application dans des cas spécifiques nécessite une compréhension approfondie des mécanismes biologiques que font intervenir les parasites et leurs ennemis. Ils incluent trois idées forces : Tout d'abord, dans la mesure du possible, la lutte doit reposer sur l'utilisation des ennemis naturels des parasites. Les méthodes qui perturbent gravement la régulation naturelle des populations de parasites ne doivent jamais être utilisées. Ensuite, l'activité des ennemis naturels des parasites doit être favorisée, directement ou indirectement, et l'on doit mettre à profit la résistance des plantes pour limiter le recours à une lutte chimique nécessitant des moyens importants. Enfin, la lutte chimique doit être sélective et ne doit être employée que lorsque les populations de parasites atteignent un niveau qui entraînerait d'importantes pertes économiques. La troisième proposition appelle des explications supplémentaires. Dans la plupart des cas, les populations de parasites sont faibles après la plantation, mais en l'absence de moyens de lutte adaptés, elles augmentent rapidement au fur et à mesure que les cultures se développent. Cependant, jusqu'à un certain niveau, les dommages subis par les cultures ont une importance économique limitée ou nulle. Le niveau de population pour lequel la proportion des dommages atteint une dimension économique est désigné comme la limite économique pour un type de parasite donné. C'est seulement au-delà de cette limite que les moyens chimiques peuvent être employés. Cette façon de procéder favorise le développement des ennemis naturels des parasites et évite de gaspiller des produits chimiques coûteux. La notion de limite économique est évidemment mouvante et diffère selon les cultures, les parasites et, comme elle dépend de la valeur marchande d'une culture, des saisons. Néanmoins, elle a prouvé son efficacité en réduisant les coûts de production. Elle est maintenant très largement utilisée dans les programmes de lutte. La lutte intégrée dans la pratique Les armes à la disposition de l'agriculteur sont de quatre natures : lutte biologique, façons culturales, usage sélectif des pesticides et résistance des cultures. La lutte biologique fait appel aux ennemis naturels des parasites. L'introduction (ou, dans certains cas, la réintroduction) d'ennemis naturels est aujourd'hui une notion familière. Bien que l'on ait pu observer quelques succès spectaculaires (la destruction des cactus opuntia par une pyrale en Australie, ou des cochenilles australiennes sur les agrumes en Californie, par exemple), il faut reconnaître que moins de la moitié des tentatives de lutte biologique par introduction d'une espèce ont réussi. Bien que les raisons de ce succès mitigé soient complexes, ces résultats soulignent l'importance du maintien des agents de lutte existants à travers l'usage sélectif des pesticides. Ce principe s'applique particulièrement aux régions tropicales, où de nombreuses cultures sont menacées par de multiples espèces de parasites. Même si l'effet d'un élément de cet ensemble de parasites est à lui seul relativement faible, la combinaison des différents effets peut avoir des conséquences catastrophiques. Introduire des prédateurs ou des parasites spécifiques pour combattre chacun des parasites ne pourrait constituer une méthode économiquement viable, même si l'on parvenait à sélectionner ces espèces. Il est alors plus judicieux de renforcer l'activité des ennemis naturels, dont un grand nombre se nourrissent de façon non sélective. Les façons culturales et la gestion du milieu naturel environnant, qui sert d'habitat aux parasites, ont pour but d'accroître les chances de survie des ennemis naturels ou de réduire celles des parasites. L'une des premières méthodes qui vient à l'esprit est de remplacer la monoculture par la polyculture. Cette mesure peut réduire la taille des populations de parasites en limitant les quantités de nourriture disponibles et en offrant des refuges de substitution aux ennemis naturels. La pratique de la culture dérobée vise les mêmes objectifs mais à une plus petite échelle. D'autres méthodes prévoient la constitution de refuges (qui ne sont pas nécessairement des cultures) ou de sources de nourriture à l'intention des ennemis naturels. Dans certaines situations, le désherbage total des cultures peut provoquer une diminution des rendements car les «mauvaises herbes» peuvent constituer un refuge et une source de nourriture pour les ennemis naturels. La destruction des résidus de culture par arrachage ou brûlage interrompt parfois le développement des parasites en phase de repos dans ces résidus. L'utilisation sélective des pesticides est une autre possibilité. Son principe le plus important est le respect des limites économiques, principe qui permet de réduire la quantité de pesticides appliquée. Cependant, les évolutions récentes dans la conception des pesticides et leur mode d'application peuvent permettre de réduire les quantités de produits à épandre sur les cultures. L'endosulfane (Thiodan), par exemple, efficace contre une grande variété de parasites, n'est que peu nocif, aux quantités recommandées, vis-à-vis des chalcidiens qui sont des ennemis naturels importants de nombreux parasites. Utilisé en formulation à ultra-bas volume (UBV) destinée à lutter contre la mouche tsé-tsé, cet insecticide n'a manifesté aucun effet détectable sur les autres populations d'insectes. Les insecticides dont l'action est fondée sur des régulateurs de croissance hormonaux ou des agents microbiens présentent également une certaine sélectivité dans leurs effets. Il est possible d'atteindre une sélectivité encore plus grande par une formulation et une application précises des pesticides. Les insecticides systémiques étant répartis sur le feuillage ou les racines de la plante, ils ne touchent que les insectes qui sucent ou qui mâchent ces feuilles ou ces racines. Le même principe prévaut pour les pesticides encapsulés, c'est-à-dire enveloppés de gélatine ou d'une autre substance inerte. Les minuscules capsules adhèrent à la surface de la plante et ne peuvent être absorbées que par des insectes qui mordent la plante pour s'en nourrir. Ce principe élimine les risques pour les prédateurs et les parasites ennemis. De nouvelles techniques De nouvelles techniques d'application peuvent permettre de réduire les quantités de pesticides nécessaires pour une protection efficace. L'épandage à ultra-bas volume (UBV) est actuellement largement utilisé, particulièrement dans le cas des applications aériennes. Une buse tournante casse le jet en un brouillard de minuscules gouttelettes. Les gouttelettes sont suffisamment petites pour pénétrer directement dans le corps de l'insecte à travers les stigmates, c'est-à-dire les pores à travers lesquels les insectes respirent, et les tuent ainsi plus rapidement. Les quantités d'insecticide nécessaires pour une protection efficace sont souvent réduites ainsi d'un facteur 100. Un inconvénient de l'épandage UBV est que les gouttelettes sont si petites qu'elles peuvent être emportées par le moindre souffle de vent, ce qui en réduit l'efficacité. Une technique ingénieuse, appelée déposition électrostatique, élimine ce problème en affectant à chaque gouttelette une minuscule charge électrostatique positive. La surface La pulvérisation de la plante qui porte une faible charge d'insecticides est efficace, négative, attire les gouttelettes vers la cuticule. Le pesticide est ainsi littéralement «collé» à la plante par des forces électriques ! Un pulvérisateur portable, bon marché et utilisant ce principe est actuellement commercialisé et se révèle extrêmement efficace dans le Tiers-Monde, particulièrement dans la lutte contre les parasites du coton. Le renforcement de la résistance des plantes est un autre aspect de la lutte intégrée contre les parasites. La phylogénétique a joué un rôle crucial, au cours du XXème siècle, dans la prévention des pertes dues aux maladies et la résistance aux maladies constitue l'un des principaux objectifs dans le développement de nouvelles variétés. L'idée de sélectionner les plantes en vue d'accroître leur résistance aux insectes parasites est plus récente mais connaît un succès considérable. Les recherches dans ce sens se poursuivent activement, en particulier dans le cas des cultures tropicales. L'Institut international de recherche sur le riz aux Philippines, quia développé une gamme de variétés de riz résistantes aux insectes, est un bon exemple de cette démarche. Cet institut a sélectionné des variétés résistantes aux quatre principaux insectes parasites du riz, qui sont maintenant cultivées en grandes quantités en Asie du SudEst. Plusieurs variétés, capables de résister à la fois à trois des quatre principaux insectes nuisibles, sont disponibles. Des variétés résistantes aux parasites du niébé, une légumineuse tropicale d'importance majeure, sont développées à l'Institut international d'agriculture tropicale (LITA) au Nigeria, au moyen de biotechnologies avancées. Les succès de la lutte intégrée La lutte intégrée a connu l'un de ses premiers succès dans la vallée de Canete au Pérou où, depuis les années 40, le coton était cultivé en monoculture accompagnée d'épandages massifs d'insecticides. En 1955, les rendements s'effondrent à la suite de l'application exagérée d'insecticides organochlorés et organophosphorés qui provoque la rupture de l'équilibre naturel et le développement de parasites résistants aux poisons. En 1956, le gouvernement introduit la rotation obligatoire des cultures, la polyculture et impose un retour aux insecticides traditionnels. L'un d'entre eux, l'arsénate de plomb, est un poison pour l'estomac qui tue uniquement les insectes qui mâchent la plante et ne produit pas d'effet sur les ennemis naturels de ces insectes. Ces mesures sont associées à des inspections régulières des cultures destinées à imposer aux agriculteurs de limiter l'usage des insecticides aux cas où la population de parasites dépasse les limites économiques. A la suite de ces interventions, les rendements du coton se rétablissent à des valeurs proches de celles que connaissaient les cultivateurs avant la crise. Quarante ans plus tard, la vallée de Canete demeure l'une des principales régions productrices de coton du Pérou. La lutte intégrée n'a pas été employée très largement en Afrique mais elle a abouti à quelques succès. La cochenille farineuse du café était l'un des principaux parasites du café au Kenya où sa population avait connu une véritable explosion due à la résistance acquise aux insecticides organochlorés persistants et à la disparition de ses ennemis naturels. Des mesures incluant des restrictions dans l'utilisation de ces pesticides combinées à l'introduction et à la dissémination des chalcidiens (Anagyrus sp.) ont eu raison de ce parasite. De même, on a pu lutter avec succès en Tanzanie contre un parasite de la canne à sucre, la cochenille de la canne à sucre, par des applications précisément espacées dans le temps de pesticides associées au lâcher de coccinelles qui se nourrissent spécifiquement de ce parasite. Le manioc, qui constitue la nourriture de base de 200 millions d'Africains, est gravement menacé par la cochenille du manioc provenant d'Amérique du Sud et introduite accidentellement il y a 20 ans. Dans ce cas précis, la lutte biologique de type classique a rencontré un grand succès. Un parasite de la cochenille de la canne à sucre, originaire lui-même d'Amérique du Sud, a été disséminé par largage aérien et s'est révélé efficace contre son ennemi dans de larges zones d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. En Asie, l'Indonésie a subi, ces dernières années, de graves diminutions des rendements de riz dues aux destructions causées par des ciccadelles brunes. L'usage abusif des insecticides est à l'origine de ce phénomène, les parasites étant devenus résistants à un grand nombre d'entre eux. En 1986, 100 000 ha de riz ont été détruits uniquement par ce parasite, en dépit des quatre ou cinq applications de pesticides effectuées durant la période de croissance des plantes. En 1988, le gouvernement indonésien a pris la décision d'interdire 57 types d'insecticides et de réduire notablement les quantités d'insecticides à base de carbamates. Ces mesures ont permis aux populations d'ennemis naturels de se renouveler et de mener une lutte appropriée contre la ciccadelle brune. Entre 1986 et 1988, le rendement moyen du riz en Indonésie est passé de 6,1 à 7,4 t/ ha, soit une augmentation de 21 % en deux ans. Etant donné que ce résultat a été obtenu uniquement en réduisant les quantités d'insecticides appliquées et donc les coûts de production, l'utilisation rationnelle des insecticides a vu ses avantages confirmés. A la suite de ce succès, la FAO organise actuellement des programmes expérimentaux de protection intégrée du riz dans six autres pays de la région. Autant de revers que de succès La lutte intégrée n'est pas une panacée. Elle a connu, tout comme la lutte biologique, autant de revers que de succès. Il faut reconnaître que l'IPM requiert des agriculteurs une meilleure connaissance des parasites et de leurs ennemis naturels que ne l'exige la lutte chimique. Il est également difficile pour les cultivateurs de rester «sans rien faire» tant que la population des parasites n'atteint pas une limite économique, alors qu'ils sont manifestement présents dans les cultures. Cela leur est d'autant plus difficile qu'on leur a conseillé auparavant d'épandre des insecticides au moindre signe de la présence de parasites. Par ailleurs, la lutte intégrée ne peut être employée contre tous les types de parasites. Il s'est révélé impossible de concevoir des dispositifs permettant de venir à bout des parasites migratoires tels que les locustes et des parasites vivant dans le sol comme les termites. L'avenir, une question de prix L'IPM n'est utilisée que pour traiter une très faible proportion des cultures dans le monde. Mis à part les problèmes précédemment mentionnés, le rapide développement des pyrèthroïdes de synthèse depuis les années 70 a permis de résoudre le problème de la résistance des parasites aux anciens produits. Néanmoins, le besoin d'une gestion rationnelle de la lutte contre les parasites se fera de plus en plus sentir dans l'avenir. Le problème de la résistance des parasites ne va pas simplement disparaître (certains insectes manifestent déjà une résistance vis-à-vis des pyrèthroïdes) et le coût des produits destinés à l'agriculture, largement tributaire du prix du pétrole, risque de continuer à augmenter fortement. La nécessité de garantir l'approvisionnement en nourriture a conduit à accorder une plus grande importance à l'efficacité de l'activité agricole. Or, l'IPM joue un rôle important dans les résultats de l'agriculture. Elle s'est montrée plus efficace lorsque les agriculteurs disposaient des moyens et de la formation nécessaires pour mener une stratégie de lutte à long terme, mais il existe de nombreux pays, notamment africains, où ces conditions ne sont pas encore réunies. A moyen terme, il est probable, ne serait-ce que pour des raisons économiques, que l'on fera un usage plus rationnel des insecticides, fondé sur la surveillance des cultures. L'évolution à long terme vers une lutte totalement intégrée ne dépendra pas uniquement de considérations purement techniques, mais aussi de facteurs économiques et politiques.
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | News Item biblioteca |
| Language: | French |
| Published: |
Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation
1990
|
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10568/59428 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|